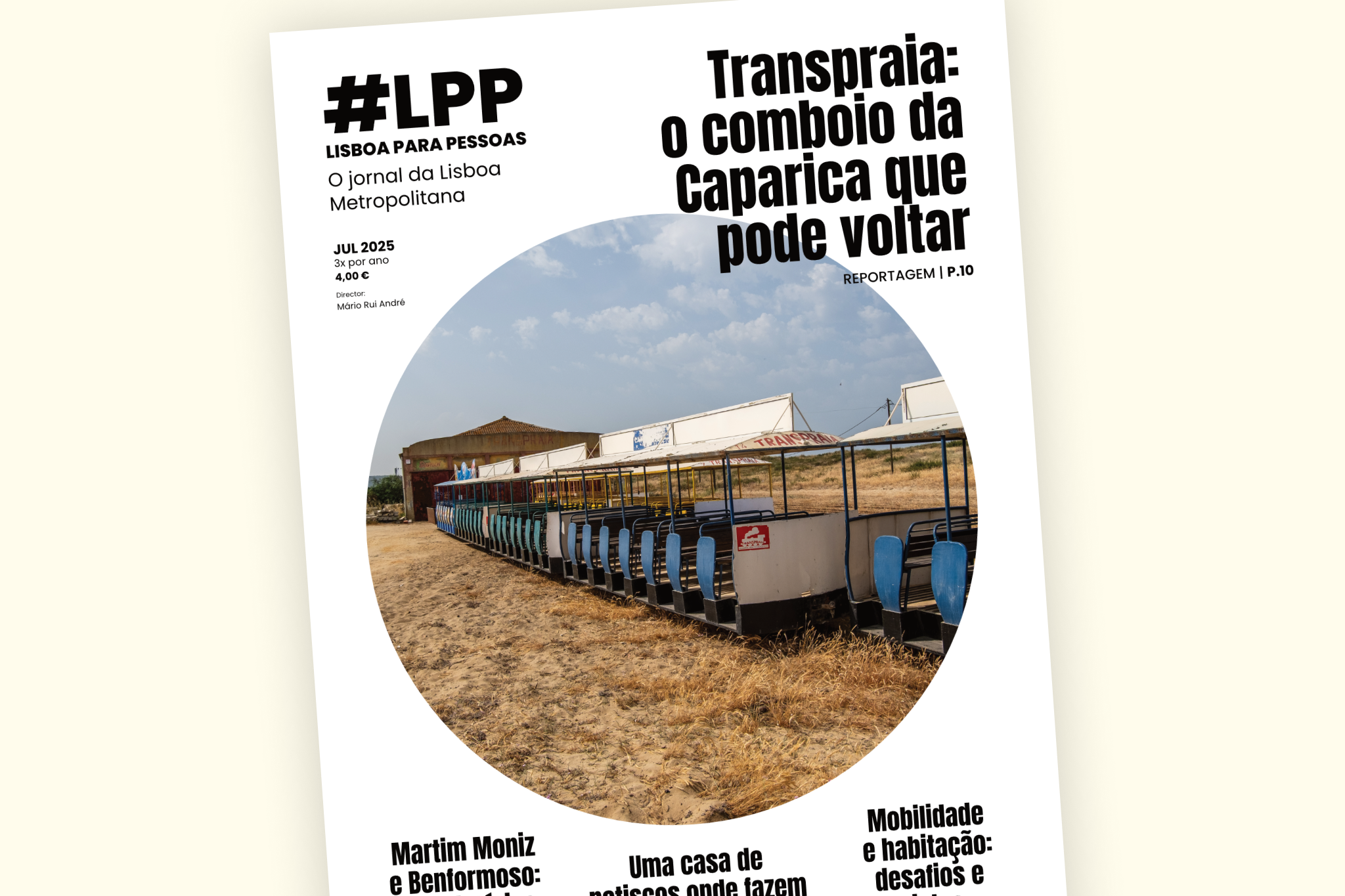Rute Nieto Ferreira est une urbaniste qui travaille avec le studio danois Gehl pour planifier et concevoir des villes pour les gens. Dans cet entretien, elle évoque la valeur de la rue en tant qu'espace de socialisation, ainsi que l'importance de mener des projets pilotes et de collecter des données pour soutenir les transformations de la ville.

C'était à la fin du mois de septembre, à Costa da Caparicaà Almada, que l'urbaniste Daniel Casas Valle a présenté à l'occasion d'une conférence de presse. l'avenir de la conception des ruesL'objectif de ce livre est d'apporter des connaissances plus techniques - qui souvent ne sortent pas du cercle de l'urbanisme - aux personnes qui décident et travaillent sur le territoire dans les mairies, mais pas seulement. Il s'adresse aussi aux gens ordinaires qui utilisent la ville, qui ont des commerces ouverts sur l'espace public, qui se déplacent quotidiennement dans des rues pleines de voitures.
Daniel n'était pas seul lors de la présentation de son livre sur la Costa, qui a été suivie d'un atelier au cours duquel les techniciens municipaux et la population locale ont réimaginé les environs du marché municipal. Depuis Porto, il s'est rendu en voiture à Rute Nieto Ferreira. Elle est architecte et urbaniste, et donc une collègue professionnelle. Rute a près de deux décennies d'expérience dans différents studios et travaille actuellement dans la ville d'Invicta, au sein du célèbre Gehl Architects - Studio danois fondé en 2000 par Jan Gehl ainsi que par l'urbaniste Helle Søholt, dans le but de poursuivre le travail de Gehl en termes de réflexion sur les villes d'un point de vue plus humain. Penser la ville au-delà des bâtiments, en la vie entre les bâtiments. Concevoir des rues, des places, des espaces publics qui centralisent les personnes, y compris les enfants, et où il existe une dynamique sociale. Parler de la qualité de vie, de la marche et du vélo.
Gehl a réalisé des projets dans plus de 300 villes. Rute Nieto Ferreira a travaillé sur certains de ces projets depuis Porto. A l'effervescence des activités à Costa da Caparica ne nous permettait pas de prendre le temps de nous asseoir et de discuter calmement, nous avons donc pris rendez-vous pour un zoom des jours plus tard. Dans cet entretien, nous parlons de la valeur de la rue en tant qu'espace de socialisation, ainsi que de l'importance de mener des projets pilotes et de collecter des données pour soutenir les changements dans la ville auprès des décideurs et de la population ; nous parlons également du rôle de l'éducation, du manque de transparence des projets d'urbanisme et de la création d'un consensus dans les villes polarisées.
Je commencerai par une provocation : comment définissez-vous l'avenir du design de rue ? Et sommes-nous, ici au Portugal, si loin de cet avenir ?
Les rues sont l'un des principaux éléments constitutifs de la ville. Il est donc fondamental de réfléchir à l'avenir des rues et des espaces. Il me semble qu'il y a eu des changements positifs au Portugal, mais que tout se passe très lentement. Je pense qu'il est clair qu'il faut recalibrer, rééquilibrer l'espace alloué aux voitures particulières et aux autres moyens de transport.
Mais cela ne se fait pas de manière très systématique et connectée, et pas assez rapidement non plus. Il semble que la théorie soit comprise, mais que la pratique prenne beaucoup de temps à se mettre en place.
"Il faut recalibrer l'espace alloué à la voiture particulière et à d'autres moyens de transport. Mais cela ne se fait pas de manière très systématique et connectée".
Pourquoi devrions-nous le faire ? Si nous disposons de tant de références et d'exemples de réussite dans tant de villes, il nous suffirait de poser notre candidature.
Je ne sais pas comment répondre à la question de savoir pourquoi. Je peux faire quelques suppositions qui peuvent être erronées. Il me semble qu'il y a peu de volonté politique. Au Portugal, nous pensons beaucoup à court terme, en d'autres termes, aux trois ou quatre prochaines années de mandat ; il n'y a pas de volonté politique à long terme de penser aux générations. Il y a de bons petits projets ici et là, mais ils ne sont pas pensés de manière systématique. Et parfois, il n'y a pas le courage politique de faire certaines choses.
Chez Gehl, nous avons des exemples de projets que nous avons réalisés dans des villes comme Copenhague ou New York et qui ont fait l'objet de transformations relativement rapides. Mais il ne s'agit pas seulement de rapidité. Il s'agit de le faire rapidement et de manière cohérente. En d'autres termes, dans ces villes, il n'y a pas eu d'arrêt-départ. Lorsqu'elles ont commencé, elles l'ont fait sérieusement et, chaque année, de petites améliorations ont été apportées. Lorsque vous regardez des photographies de Copenhague dans les années 1950, jusqu'aux années 1960, vous voyez que la ville ressemblait beaucoup à de nombreuses régions du Portugal : des places pleines de parkings, la voiture était très visible dans le centre-ville. Peu à peu, la ville a commencé à aménager des rues piétonnes. On a commencé par une rue, puis on l'a élargie, puis on en a créé deux, trois, quatre autres. Chaque année, des rues et des places ont été débarrassées de leurs parkings afin que les gens puissent gagner ces espaces, qui appartenaient auparavant aux voitures et qui leur appartiennent désormais. Cela s'est fait petit à petit, mais jamais sans séparation.
En d'autres termes, il y a eu ce courage initial, puis les gens eux-mêmes ont réalisé que c'était une chose positive. C'est ainsi que les choses se sont poursuivies.
L'exemple de New York est plus récent, il date des années 2000 ; en trois ans, on y a construit plus de pistes cyclables qu'à Copenhague à l'époque, en termes de kilomètres. Le maire et son cabinet souhaitaient ardemment faire de New York une ville où les gens utilisent le vélo, une ville où les places et les rues sont considérées comme des lieux de vie, où les gens comptent aussi, et pas seulement les voitures.
"Il y a eu ce courage initial, puis les gens eux-mêmes ont réalisé que c'était une chose positive. C'est ainsi que les choses se sont poursuivies.
Comment provoquer cette volonté politique initiale ? Comment convaincre les décideurs ?
Je pense que parfois, il ne s'agit même pas de convaincre, mais plutôt de démontrer. Dans certains cas, il est possible de mener des projets pilotes, de montrer les choses plutôt que de se contenter d'en parler. On peut commencer à petite échelle et réaliser de petits projets de démonstration. Et on peut collecter des données avant, pendant et après, aussi pour calmer les gens, comme les commerçants qui pensent qu'ils vont perdre du chiffre d'affaires mais qui se rendent compte que ce n'est pas le cas et qu'après tout, les gens qui arrivent à pied ou à vélo achètent même plus souvent, viennent même plus souvent dans les magasins.
En d'autres termes, il faut parfois proposer quelque chose de concret. Il ne suffit pas d'expliquer que cela a bien fonctionné dans la ville X ou Y, mais il faut le faire dans la ville elle-même et réaliser ces projets de démonstration.
Il peut aussi y avoir une certaine crainte des tests, non ?
Mais ces projets sont peu risqués, parce qu'ils sont temporaires et qu'il est toujours possible de revenir à la situation antérieure, et qu'il n'y a pas de coûts d'infrastructure importants. Il s'agit en effet de mettre en place des barrières amovibles, de peindre la chaussée, de fermer temporairement une rue. On peut même commencer par ne le faire que le week-end ou tous les X temps.
"Parfois, il faut proposer des choses concrètes. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer que cela a bien fonctionné dans la ville X ou Y, mais dans la ville elle-même et de réaliser ces projets de démonstration."
Ces choses sont relativement simples et ensuite, si elles fonctionnent, avec les données et les observations sur la façon dont elles se sont déroulées, nous pouvons les faire passer de temporaires à définitives. Et c'est presque l'accomplissement de la population. C'est un test qui a été fait, qui a été jugé utile et auquel tout le monde a participé, plutôt que quelque chose qui vient d'en haut, d'une mairie ou d'un service qui arrive en disant qu'il va le mettre en œuvre et qui commence à tout casser dans la rue.
Je pense aussi qu'il y a un problème d'implication de la population. Je le dis plus en tant que citoyen - car malheureusement je travaille sur très peu de projets au Portugal - mais je pense qu'il y a un énorme manque de communication sur les projets, à la fois sur l'architecture et sur l'espace public. Il est très difficile de comprendre ce qui va ou ne va pas se passer dans un quartier ou une rue. Il y a ces panneaux qui sont toujours endommagés par le vent ou la pluie, mais il n'y a pas de plateforme numérique où je peux voir ce qui va se passer dans ma paroisse, quels sont les projets à venir. Les choses sont un peu secrètes. Il n'y a pas de débat sur l'urbanisme. Il me semble que c'est quelque chose de très fermé, ce n'est pas fait de manière claire, avec tout le monde.
Remarquez-vous une différence avec d'autres villes ?
Oui, bien sûr, mon expérience est limitée. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en Angleterre, quelques années à San Francisco et une courte période à Stockholm. Je n'ai donc d'expérience que pour ces villes. Mais, par exemple, au Royaume-Uni, dès qu'un projet d'urbanisme existe - il n'a pas besoin d'être approuvé - il fait partie du domaine public. En d'autres termes, je peux aller enquêter dans ma rue, mon quartier ou une zone spécifique dans laquelle je travaille et voir quels sont les projets en cours. Ils n'ont pas encore besoin d'être autorisés. Il suffit que quelqu'un ait demandé une modification pour qu'elle soit en ligne et que je puisse consulter les plans, la description, etc. Il s'agit de projets publics et privés.
Ce serait impensable au Portugal. Cette communication de ce qui se passe dans les rues, les places et les bâtiments ne se fait pas. Ce n'est pas quelque chose de facile d'accès, on a l'impression que c'est réservé à quelques-uns, à ceux qui comprennent. Et comme il n'y a pas de débat ouvert au grand public, la méfiance s'installe. Les gens pensent qu'il n'y a pas de bonnes intentions parce qu'on n'en parle pas. Et je ne pense pas que cette méfiance soit mauvaise de la part des gens. Elle existe à cause de ce manque d'ouverture.
"Il y a un énorme manque de communication sur les projets, qu'il s'agisse d'architecture ou d'espace public. Il est très difficile de comprendre ce qui se passe ou ne se passe pas dans un quartier ou une rue. Les choses sont un peu secrètes. Il n'y a pas de débat sur l'urbanisme.
Et ces doutes ne portent pas seulement sur le projet qui sera réalisé, mais aussi sur les raisons pour lesquelles il sera réalisé.
C'est tout à fait exact. Je pense que le Portugal, du peu que je connais, en tant que citoyen, je pense qu'il y a un fossé énorme entre la question du PDM [Plan directeur municipal] et la question des projets d'exécution. Il n'y a rien entre ces deux échelles. Le PDM est un outil assez froid, rigide, statique. Et puis il y a les projets pour casser la pierre, pour faire des pistes cyclables, des places, des rues.
Et entre les deux, où est le projet stratégique ? Où est cette vision d'avenir qui explique pourquoi on fait ce travail parce qu'un corridor vert a été défini il y a 10 ou 20 ans ? Où est le pourquoi des choses ? Souvent, le PDM ne le fait pas. Et on ne se rend pas compte de l'origine de ces projets ponctuels.
C'est pourquoi il manque parfois cet entre-deux, ces projets stratégiques, pour faire des liens entre les choses, pour créer du sens, et peut-être faut-il les penser davantage à l'échelle du quartier, et non de la ville. Évidemment, ce n'est pas faire des plans pour faire des plans, c'est faire des plans dans cette perspective d'aller de l'avant.


Comment faire en sorte que les connaissances en matière d'urbanisme, qui ne sont souvent détenues que par des spécialistes, soient mises à la portée des citoyens ? Et comment l'activer avec eux ? Par le biais de débats, par exemple ?
Je pense que l'école est fondamentale. Nous allons tous à l'école. Et je pense que l'on parle très peu d'urbanisme, de villes, de qualité de vie, de transports. Et ce n'est pas qu'un discours, je pense qu'il y a aussi peu d'engagement entre les enfants et leur propre ville. Il y a peu de sorties scolaires et peu d'enseignants emmènent les enfants dans le métro. Je ne connais pas beaucoup de projets visant à apprendre aux enfants à faire du vélo ou à marcher de la maison à l'école. Et les projets qui existent sont des exceptions.
Je pense donc que cette relation entre l'école et la ville pourrait être beaucoup plus importante. Commencer dès le plus jeune âge a des avantages, nous savons que ce sont des choses qui portent leurs fruits plus tard. Si l'on commence à marcher ou à faire du vélo dès l'enfance, c'est quelque chose qui dure toute la vie, avec une valeur ajoutée en termes de santé publique, d'environnement et même de santé mentale.
Mais oui, les débats et les conférences sont également importants pour ces transferts. Les projets pilotes dont nous avons déjà parlé. Et même le temps d'antenne que ces choses reçoivent à la radio, à la télévision et dans les journaux, qui est très faible au Portugal. Plus il y a de temps d'antenne, plus cela reflète une société qui s'intéresse à ces choses, qui en parle, qui en débat. Je pense que cela doit venir de plusieurs sources. Il n'y a pas qu'une seule approche pour résoudre ce problème. Mais si je devais en choisir une, je me concentrerais sur la question des enfants et des écoles.
"Les relations entre l'école et la ville pourraient être bien meilleures.
Il manque également une formation plus poussée pour le personnel technique des chambres et des organisations qui décident du territoire.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est le cas. Je pense que s'il y a un changement de mentalité, il est beaucoup plus facile de faire bouger les choses. En fait, Jan Gehl, qui a fondé et donné son nom à l'entreprise dans laquelle je travaille, dit toujours que la chose la plus importante qu'il ait faite n'était pas des projets : c'était d'écrire des livres, parce que les livres touchent plus de gens. Et grâce à eux, vous pouvez amener un maire, un département, une demi-douzaine de personnes influentes à changer leur mentalité, à comprendre certaines choses sur la qualité de vie, l'accès aux rues pour marcher, aux places pour se retrouver et socialiser, l'accès à pied aux magasins et aux services, aux espaces de loisirs, etc. Qu'ils se rendent compte de petites choses sur la ville et comment elle peut fonctionner. C'est un long chemin, car si les gens comprennent les choses, s'ils ressentent ces enjeux, les projets sont plus faciles à faire et à réaliser.
Les arguments et la résistance sont souvent les mêmes. Il existe plusieurs schémas. Si les problèmes soulevés par les commerçants, par exemple, sont toujours les mêmes et si, dans la plupart des cas, le fait de retirer de l'espace aux voitures ne nuit pas à leur activité, pourquoi en parlons-nous toujours ?
Je pense que c'est normal, parce que nous sommes tous humains et que nous sommes tous résistants au changement. Je ne pense donc pas qu'il faille blâmer les commerçants ou les personnes qui s'opposent à certaines choses d'avoir cette réaction négative. Parce que changer quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien provoque toujours une résistance ; c'est un processus normal de changement dans les villes. Il est plus facile de procéder à ce changement s'il existe des exemples concrets d'autres rues, avec lesquels vous pouvez montrer l'avant et l'après, en vous appuyant sur des données et des études.
Je ne pense pas non plus qu'il faille être naïf et penser que les choses fonctionnent toujours. C'est la raison pour laquelle des projets pilotes sont menés. Parfois, il faut prendre du recul, réanalyser et modifier le plan initial. Dans une rue pleine de commerçants, où ils sont tous différents, il y en aura probablement un ou deux qui seront perdants parce qu'ils ont une clientèle très spécifique qui ne vient plus parce qu'elle arrive toujours en voiture ou pour une raison très spécifique. Il ne faut pas être trop optimiste et penser que tel ou tel changement fonctionnera pour tout le monde.
"Je ne pense pas que nous puissions être naïfs et penser que les choses fonctionnent toujours. C'est pourquoi nous menons des projets pilotes. Parfois, il faut prendre du recul, réanalyser et modifier le plan initial.
Chaque cas est différent et je pense qu'il faut aussi penser aux personnes qui n'ont pas toutes leurs facultés, qui auront besoin d'être transportées à certains endroits. Je pense donc qu'il doit toujours y avoir des exceptions. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une radicalisation qui consisterait à supprimer les voitures partout. Je pense que les voitures seront nécessaires et que nous devrons coexister avec elles pendant plusieurs décennies. Maintenant, c'est très différent d'avoir une voiture de temps en temps qui va à cinq ou dix kilomètres à l'heure, c'est-à-dire à la vitesse d'un piéton, ou de l'avoir qui va à 50 ou même 30 kilomètres à l'heure. Ou lorsqu'il y a un flux énorme où les gens doivent marcher au milieu en faisant des gymkhanas au lieu que ce soit les voitures qui fassent des gymkhanas. Il faut rééquilibrer les choses, en pensant d'abord aux populations les plus vulnérables, à savoir les enfants et les personnes âgées. Et quand on pense aux plus vulnérables, on fait presque toujours une meilleure ville pour tout le monde, n'est-ce pas ?

Nous avons vu des villes divisées et polarisées entre automobilistes et cyclistes, et ces rôles ne sont pas absolus. Comment créer un consensus ?
Je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse. Je pense qu'il faut plusieurs choses en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait une seule façon de convaincre ou de dire que certains ont tort et d'autres ont raison. Une chose est vraie : les automobilistes et les cyclistes sont tous des personnes et presque tous, presque certainement, marchent. Alors revenons à l'essentiel : nous sommes tous des personnes qui, plus ou moins, se déplacent en même temps, à la même vitesse : nous avons plus ou moins les mêmes sens, la même taille, certains en poussette, d'autres en fauteuil roulant. Mais nous sommes tous humains, il y a des choses que nous voulons tous. Mais je pense que les gens se focalisent trop sur l'individu et sur l'idée qu'ils ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Et bien sûr, c'est le cas.
"Je ne pense pas qu'il soit possible de convaincre ou de dire que certains ont tort et d'autres ont raison. Une chose est vraie : les automobilistes et les cyclistes sont tous des personnes et la quasi-totalité d'entre eux, presque à coup sûr, marchent".
Nous ne pouvons pas blâmer l'individu parce qu'il a fait ce choix parce que c'est le meilleur. C'est le choix qu'il peut faire maintenant. En d'autres termes, s'il n'y a pas de moyen de transport permettant à cette personne d'arriver à l'heure au travail, d'aller chercher ses enfants à l'école, d'aller au supermarché et ainsi de suite, on ne peut pas lui reprocher d'avoir besoin d'un travail et d'une voiture pour s'y rendre. En tant qu'êtres humains, nous allons choisir ce qui est le plus facile et le plus pratique pour notre vie quotidienne.
Mais nous avons également besoin que l'infrastructure des villes soit là pour nous, car sinon les choix que nous ferons seront ceux que nous pouvons faire et non ceux qui sont bons pour la planète ou pour la santé publique. Nous sommes tous les jours dans des villes où il y a beaucoup de trafic et où la qualité de vie laisse à désirer, en grande partie à cause des voitures. La défaite ne sera pas aussi rapide que nous le souhaiterions, mais je pense que la défaite ne consiste pas à blâmer l'individu, mais plutôt l'existence d'infrastructures, qui doivent être construites petit à petit - mais de manière cohérente - pour permettre aux gens d'adopter naturellement d'autres modes de vie, avec une valeur ajoutée pour leur santé et leur qualité de vie.
"Nous ne pouvons pas blâmer l'individu parce qu'il a fait ce choix parce que c'est le meilleur (...) Mais nous avons aussi besoin que l'infrastructure des villes soit là pour nous, parce que sinon les choix seront ceux que nous pouvons faire et non ceux qui sont bons pour la planète ou pour la santé publique".
Personne ne veut de villes sans voitures. Juste des villes avec moins de voitures.
Oui, mais cette question implique aussi des moments de courage politique, d'acceptation d'idées qui peuvent sembler plus radicales, mais qui doivent parfois se concrétiser, comme dans le cas des centres-villes. Aujourd'hui, on ne peut plus dire - car les exemples sont nombreux - qu'il est radical d'éliminer les voitures des centres-villes. Dans des villes comme Londres, la pollution dans le centre-ville a été considérablement réduite depuis que des restrictions ont été mises en place pour les voitures. Ils ont commencé par une petite zone et l'ont étendue plusieurs fois. Il existe d'autres cas et études dans diverses villes européennes où les voitures ont été retirées du centre avec des résultats très positifs. Les gens ont continué à avoir des voitures, mais il y avait plus de règles concernant l'utilisation de la voiture et les raisons de cette utilisation. Les gagnants sont les centres-villes, les personnes qui s'y trouvent, qui s'y rendent d'une manière différente, qui se déplacent davantage et qui socialisent plus.
Les rues ne sont pas réservées à leurs habitants. Souvent, on n'entend parler que des personnes qui vivent dans un certain endroit et qui bloquent les transformations qui serviront à d'autres. Comment créer un équilibre dans ce domaine ?
Nous sommes revenus au début de la conversation, à propos des rues et des places. Elles sont essentielles à la vie urbaine et nous devons nous pencher sur les principes de base d'un urbanisme plus humaniste. La marche et le vélo sont destinés à tous les membres de la société, et pas seulement à quelques-uns. Les rues et les espaces publics doivent également être considérés comme des lieux de rencontre et de socialisation. Si nous enlevons cela, nous enlevons ce que signifie être une ville. Nous ne parlons pas d'un centre commercial ou d'un lieu où l'on se rend pour consommer, pour prendre un café, pour dépenser de l'argent dans les magasins, etc. Nous parlons du principe de la ville, qui consiste à marcher, à s'arrêter, à vivre.
"Aujourd'hui, on ne peut plus dire - car les exemples sont nombreux - qu'il est radical de supprimer les voitures des centres-villes.
Nos rues et nos places ne peuvent pas être uniquement commerciales...
Oui, mais cela en fait partie. Lorsque nous pensons à l'espace public, nous pensons également à ces espaces commerciaux, mais les espaces publics ne peuvent pas être uniquement ceux associés aux zones commerciales, en d'autres termes, s'il y a une place avec des tables et des chaises de café - ce qui est une bonne chose car, dans la plupart des cas, elles apportent de la vie - il doit également y avoir des espaces, des bancs et différentes façons d'être où il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent, où l'on peut apporter un café ou un en-cas de chez soi ou s'asseoir pour parler à un ami. C'est également fondamental.


Nous parlons des rues entre les façades, mais nous devons aussi nous intéresser à ce qui se passe derrière les façades.
Oui, absolument. Je pense que tout cela est lié. Et pour en revenir à notre condition d'êtres humains, ces invitations à marcher que nous lancent les villes ont aussi beaucoup à voir avec la forme urbaine, avec l'aspect des villes et de leurs rues. Il ne s'agit pas seulement de la largeur de la route ou du trottoir, mais aussi des façades qui bordent ce trottoir, qu'elles soient vivantes et actives ou passives, par exemple parce qu'il y a un grand mur ou une balustrade. Dans ce cas, il se peut que vous ne vous sentiez pas en sécurité en vous promenant à cet endroit et que vous vous disiez : "Quelle galère, je marche 800 mètres à côté d'un mur qui n'a rien à voir". C'est différent si vous avez des maisons, des magasins, si vous avez des portes et des fenêtres, si vous avez de l'art de rue. C'est différent d'avoir des magasins ouverts ou fermés, les couleurs, les textures... Ces invitations à marcher sont super importantes et ont à voir avec la façon dont les rues sont faites, dont les villes sont faites.
Il s'agit de réfléchir à l'espace entre les bâtiments.
C'est exact. La question de la conception et de l'aménagement des rues ne se résume pas à avoir X mètres pour les piétons et X mètres pour les voitures. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi une question de façades. Une chose importante sur laquelle nous travaillons beaucoup, et qui nous vient également de Jan Gehl, est la question de toujours penser d'abord à la vie que l'on veut dans un espace, puis de penser à l'espace entre les bâtiments et seulement ensuite de penser aux bâtiments. C'est une chose que nous utilisons dans presque tous les projets, qu'il s'agisse d'un espace public ou d'un bâtiment. la planification directrice.
D'accord, nous ferons un mètre et demi de marche. Mais un mètre et demi pour quoi faire ? À quoi sert ce trottoir ? Par exemple, est-ce que je veux qu'un père et son fils marchent confortablement et que quelqu'un d'autre puisse les dépasser sans problème ? C'est une façon de marcher, de vivre. Il faut un trottoir avec une certaine distance pour pouvoir se rencontrer dans la rue. Et puis il y a l'arrêt de bus, les panneaux ou autres mobiliers urbains. En d'autres termes, il faut penser à la vie que l'on veut avoir sur ce trottoir, à la vie que l'on veut avoir sur cette place ou dans ce quartier, puis concevoir les espaces entre les bâtiments et ensuite, oui, passer aux bâtiments, aux façades.
"La question de la conception et de l'aménagement des rues ne se résume pas à avoir X mètres pour les piétons et X mètres pour les voitures.
Et pour planifier cette vie, nous devons aussi voir comment les gens utilisent déjà les espaces, n'est-ce pas ?
Oui, nous étudions la manière dont les gens utilisent l'espace. C'est un outil de travail important pour nous. Nous n'arrivons pas en tant qu'experts en disant "ah, nous avons déjà beaucoup d'expérience, nous avons visité beaucoup de villes". Non, dans presque tous les endroits, il faut faire des recherches sur place. Nous utilisons des outils que nous utilisons depuis de nombreuses années, comme l'étude de la vie et de l'espace urbains. Il ne s'agit pas seulement d'une étude physique - dans le sens où l'on cherche à savoir où se trouve le trottoir, où se trouve le bâtiment, quelles sont les dimensions - mais aussi comment les gens utilisent cet espace, combien de personnes marchent, quel sexe, quel âge, quel mode de transport, s'agit-il de la marche, du vélo, de la trottinette, de la planche à roulettes. Nous disposons généralement de données sur les voitures dans les villes, mais peu sur les personnes. Il n'y a pas beaucoup d'observation de la façon dont les gens utilisent les espaces, et cette observation, ce comptage, à la fois des personnes en mouvement et des personnes immobiles, est fondamental pour la planification. Que font-ils ? Sont-ils assis ? Sont-ils sur leur téléphone portable ? Sont-ils assis et mangent-ils ? Sont-ils assis ou couchés ? Ou sont-ils simplement adossés parce qu'il n'y a pas d'endroit où s'asseoir ?
Tous ces types d'observations sont très importants pour nous lorsque nous lançons un projet pour une municipalité. Il faut comprendre la vie pour pouvoir ensuite donner des recommandations basées sur des données réelles et non sur des choses inventées. Souvent, nous pouvons regarder en arrière parce qu'il s'agit d'un endroit où des comptages et des observations ont déjà été effectués, d'autres fois, nous pouvons comparer une place à Lisbonne avec une place dans une autre ville qui a les mêmes dimensions ou des services similaires. Comme nous disposons déjà d'une vaste base de données, nous pouvons comparer et apprendre à partir d'exemples concrets de différents sites géographiques.
Et les études ne peuvent pas être utilisées pour gagner du temps ?
Il est plus coûteux de mal faire les choses que de faire une étude. Et une étude, si elle est bien faite, peut durer de nombreuses années. Vous obtenez un plan de travail, une sorte de vision, quelque chose qui vous guide. Vous n'obtenez peut-être pas les détails, mais vous obtenez l'essence de ce que vous essayez de faire. Par exemple, cette place a été améliorée, mais pourquoi avez-vous investi ces fonds à cet endroit ? Est-ce que c'est exactement là que les gens demandaient le plus ce type d'investissement ou serait-il préférable de faire une étude pour donner la priorité à d'autres zones ? Il s'agit de réfléchir rationnellement aux raisons d'investir à certains endroits.
Parfois, on ne comprend pas vraiment pourquoi certaines choses ont été améliorées et d'autres non. On a l'impression que c'est parce que ces personnes ont parlé plus fort, parce qu'elles ont eu accès aux fonds en premier ou parce qu'il s'agit d'une zone plus privilégiée. Il y a toujours des contre-arguments, mais ce que nous essayons de faire avec ces études, c'est de penser aux gens. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'un urbanisme plus humaniste. Nous pensons aux besoins des gens.
"Nous disposons généralement de données sur les voitures dans les villes, mais peu sur les personnes. Il n'y a pas beaucoup d'observation de la façon dont les gens utilisent les espaces, et cette observation, ce comptage, à la fois des personnes en mouvement et des personnes immobiles, est fondamental pour la planification."
Même lorsque cela ne fait pas partie de ce que le client nous a demandé de faire, nous essayons toujours de réaliser une mini-étude du contexte, car sinon nous ne pouvons pas formuler de propositions concrètes et justifiées. Nous ne pouvons pas dire pourquoi nous devrions le faire sans données, sans passer du temps sur le terrain à analyser et à rassembler des données quantitatives et qualitatives.
Pour conclure : qu'avez-vous pensé de cette journée à Costa da Caparica ? Qu'avez-vous retenu de l'atelier ?
C'était une excellente idée de le faire dans la rue et dans l'espace public. C'est formidable que la Semaine de la mobilité ait été organisée dans un forum aussi ouvert, générant un débat public qui n'était pas du tout planifié. C'était très intéressant pour moi. Je ne connaissais pas beaucoup l'endroit à l'avance, mais j'ai été ravie de voir cette rue piétonne si pleine de vie, avec des magasins ouverts, des gens qui marchent, avec cette portion entre la plage et le centre, que j'ai trouvée très bien faite. Bien sûr, il est impossible pour nous, en tant que concepteurs, de nous y promener sans nous rendre compte que nous aurions pu créer une allée continue ou que nous aurions pu faire ceci ou cela.
Lors de l'atelier, nous avons eu une conversation très impliquée, avec des personnes relativement bien informées qui connaissaient bien le contexte - la plupart d'entre elles étaient des techniciens municipaux ou travaillaient avec le conseil. Les participants se sont montrés très intéressés par l'idée d'augmenter la taille de cette place pour y inclure le marché, puis de réfléchir à une hiérarchie des routes, de faire en sorte que la place du marché soit plus grande et de la rendre plus attrayante. dézoomer de réfléchir non seulement à l'échelle de la place, mais aussi à l'évolution de la circulation dans les rues périphériques et dans l'ensemble du quartier. La réflexion a été menée de manière relativement stratégique et avec des personnes qui y réfléchissaient depuis longtemps, ce qui a donné lieu à une bonne conversation.