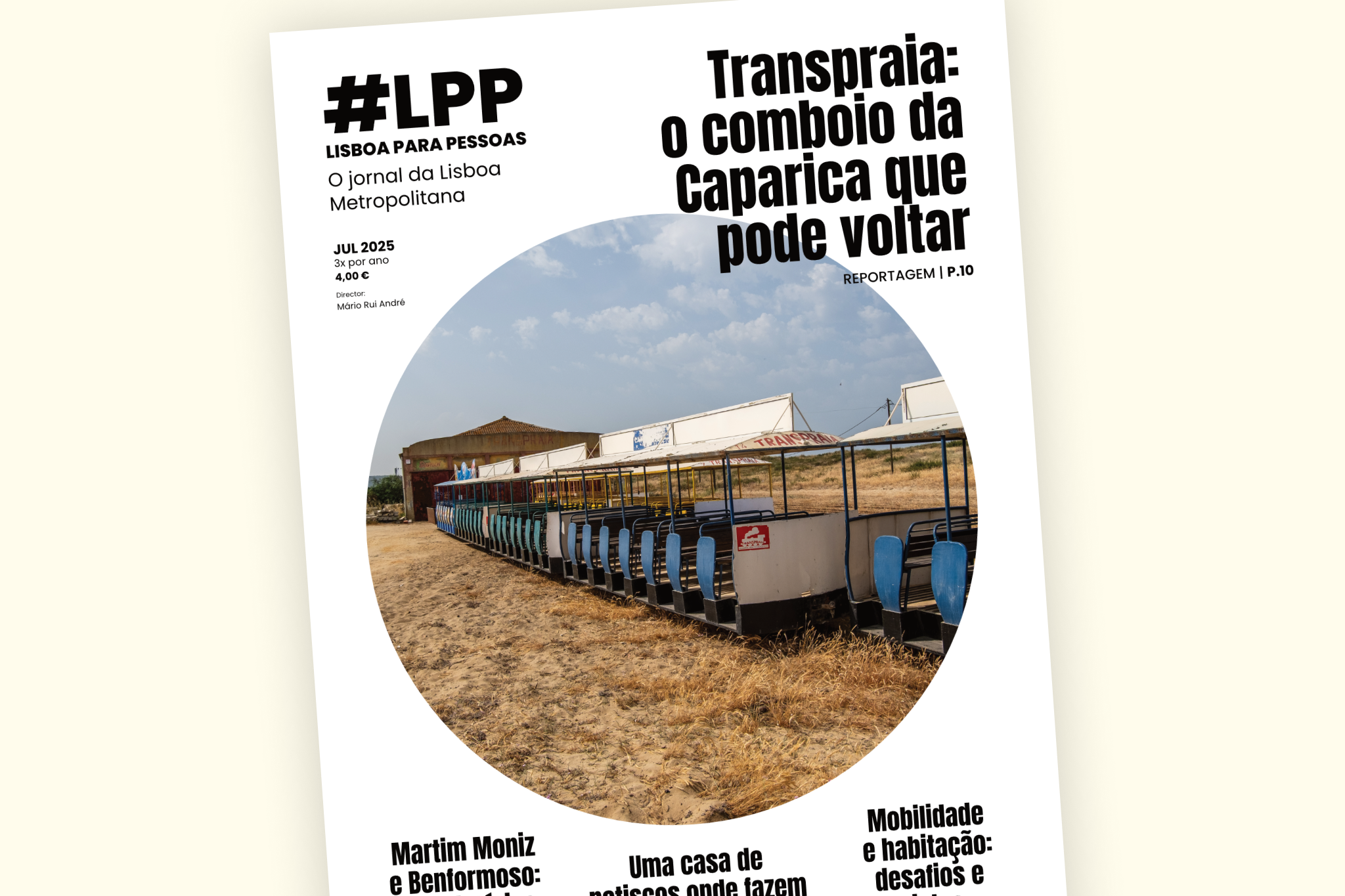Ils nous emmènent à l'école, au travail, chez le médecin et nous ramènent à la maison. Ils nous emmènent aussi à la plage et à la culture. Mais nous ne les remarquons pas toujours. Raquel Albuquerque, journaliste, a voulu donner de la visibilité à la profession de conducteur de transport public et, à travers huit histoires provenant de différentes parties du pays, parler un peu de notre société et de notre territoire.

"Chaque jour et chaque nuit, dans les rues des villes, sur les petites routes ou les chemins de terre, des milliers de conducteurs de transports publics conduisent quelqu'un à destination. Ils passent des années au volant d'un bus ou d'un tramway, à regarder les paysages changer et, s'ils sont efficaces sur quelques lignes, à accompagner les passagers à travers les différentes étapes de la vie. La profession existe depuis plus d'un siècle au Portugal, mais on connaît mal son histoire et la routine de ces professionnels, hommes et femmes, nationaux et immigrés, dont le nombre s'avère insuffisant pour répondre aux besoins croissants de ce secteur. Ce livre dresse le portrait de huit chauffeurs d'autobus et de deux serre-freins de tramway de différentes régions du pays, de leur histoire et de la façon dont ils reflètent l'évolution d'un pays en mouvement."
Ils nous emmènent à l'école, au travail, chez le médecin et nous ramènent à la maison. Ils nous emmènent aussi à la plage et à la culture. Mais nous ne les remarquons pas toujours. Ceux qui nous conduisent : histoires de conducteurs de transports publics est un un petit livre qui nous invite à nous glisser dans la peau de huit chauffeurs de transports publics qui nous font vivre au quotidien les différentes réalités de notre pays.. Par le biais d'histoires merveilleusement détaillées, Raquel Albuquerquejournaliste à Expresso, rend visible une profession que beaucoup d'entre nous ignorent et dont nous ne cessons de comprendre les difficultés.
Publié par la Fondation Francisco Manuel dos SantosLe livre va au-delà des récits des conducteurs, recueillis du nord au sud du pays. Ces récits constituent en effet un point de départ pour discuter des transformations de la société au cours des dernières décennies et des défis territoriaux du pays. C'est du point de vue de ceux qui qui nous emmènent Raquel explore des thèmes tels que la désertification de l'intérieur et les questions d'immigration, et y parvient magistralement, transformer les récits de vie en brèves réflexions sociales.
Ceux qui nous portent peut être acheté au prix de 4,50 sur le site de la Fondation Francisco Manuel dos Santosmais aussi dans les boutiques en ligne de Wook ou le FNAC. Dans cet entretien, Raquel nous parle du livre et nous révèle quelques-unes des histoires et des idées qu'on peut y lire.
Comment vous est venue l'idée de ce livre ?
Ce projet est né parce que je suis déjà le sujet de la mobilité en tant que journaliste et parce que je me suis rendu compte que l'on connaît mal le métier de chauffeur. C'est une profession que je vois tout le temps, mais je ne savais pas comment elle fonctionnait. J'étais très curieuse d'entendre leurs histoires et de comprendre ce qui les avait amenés à exercer cette profession. Mais ce qui m'intriguait encore plus, c'était de comprendre les villes et les lieux de leur point de vue. Ce qu'ils voyaient se passer dans les bus, les gens qu'ils voyaient monter et descendre, les vies qu'ils suivaient, l'évolution des lieux où ils se rendaient...
S'agissait-il d'emblée d'un livre ou d'un reportage journalistique ?
Il a toujours été prévu que ce soit un livre avec tous les détails que je pensais que ce thème méritait. Je n'ai pas décidé tout de suite combien d'histoires il y aurait, je ne savais pas vraiment parce que cela dépendrait un peu des histoires que j'inventerais.
Au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de matériel sur la profession de conducteur : peu d'études, peu d'articles académiques ou d'analyses. Il existe quelques rapports de l'IMT sur la profession, mais il y a vraiment peu d'informations détaillées. Par exemple, combien y a-t-il de conducteurs de transport public de passagers au Portugal ? L'INE ne dispose pas de ces données désagrégées, j'ai donc utilisé les données possibles, à savoir le nombre indiqué par l'ANTROP [Association nationale du transport de passagers]. Je voulais comprendre l'évolution de la profession, la répartition par âge et par sexe, le nombre de femmes parmi les conducteurs... Mais il n'y avait aucune information ou analyse sur ces points. Et ce n'est toujours pas le cas. Dans le livre, j'ai essayé de recueillir des histoires aussi complètes que possible, mais pas de manière répétitive...
Vous avez tenu à rechercher des réalités différentes, de la personne qui gare le bus à côté de sa maison, où se trouve l'arrêt de bus, à la dynamique plus urbaine de Lisbonne.
Oui, c'est ce que je voulais vraiment, parce que le pays a des réalités très différentes. Parfois, nous finissons par nous concentrer trop sur Lisbonne, non seulement parce que nous y vivons, mais aussi parce que les journaux eux-mêmes s'y trouvent. Le reste du pays n'est pas aussi bien représenté dans les médias.
Mais il est intéressant de constater que les conducteurs - et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fil de mon travail - nous en disent beaucoup sur l'histoire de notre société et l'évolution du pays, en particulier d'un point de vue démographique. En écoutant leurs histoires et l'évolution de leur profession, je me suis rendu compte que les conducteurs sont presque des observateurs de la société. Je ne pense pas que quelqu'un ait réalisé cela auparavant, même dans les cercles académiques, comme un moyen de comprendre l'évolution de la société. Honnêtement, je pense que personne ne l'avait encore compris, que ce soit dans un cadre académique ou dans le cadre de la recherche sur les systèmes de transport.

Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce travail ? Qu'est-ce que vous n'attendiez pas ?
Les différences entre les chauffeurs auxquels j'ai parlé étaient surprenantes. En d'autres termes, il y a un côté commun à toutes les histoires - et je pense que le livre en rend compte - mais c'est leur environnement qui définit réellement leurs habitudes. C'est la première conclusion que j'ai tirée : les caractéristiques démographiques des lieux où ils travaillent définissent leurs habitudes. À bien des égards, et l'un d'entre eux est aussi simple que de savoir s'ils transportent beaucoup ou peu de personnes. Il est différent d'être chauffeur dans une municipalité de l'Alentejo ou dans des régions intérieures comme Sabugal, Guarda, qu'à Lisbonne. Et il est intéressant de voir qui sont les personnes transportées et les raisons pour lesquelles les gens utilisent les bus dans ces endroits. Souvent, à la campagne, les itinéraires sont très axés sur les écoles. Et c'est amusant parce que les chauffeurs à qui j'ai parlé dans ces endroits m'ont dit qu'ils avaient des passagers réguliers, qui voyagent de leur village à la ville tous les jours, et d'autres qui utilisent le bus occasionnellement, soit pour aller au centre de santé, soit pour rendre visite à quelqu'un, soit parce que leur voiture est au garage.
J'ai été surpris par la richesse des histoires qu'ils racontent et par ce qu'ils voient au quotidien. Comme ils empruntent souvent les mêmes itinéraires chaque jour, ils finissent par voir les mêmes endroits, souvent aux mêmes heures. Ils voient les lieux changer, les gens changer, les vies changer.
Comment avez-vous trouvé ces histoires ? Et combien de temps avez-vous passé dans chaque lieu ?
J'ai contacté plusieurs entreprises de transport pour leur expliquer ce que je faisais et m'assurer que les chauffeurs avaient les autorisations nécessaires pour pouvoir parler. J'ai demandé des suggestions à des personnes qui aimaient la profession et qui pouvaient dépeindre ce qu'est le métier de chauffeur et comment les choses ont évolué au fil des ans. J'ai recherché une variété de profils de conducteurs. Je voulais inclure des femmes. Je voulais avoir des histoires de chauffeurs qui étaient chauffeurs depuis longtemps. Je voulais avoir l'histoire d'une personne qui n'était chauffeur au Portugal que depuis peu, afin de pouvoir également parler de l'immigration et de la nécessité de chercher des chauffeurs en dehors du pays. Je viens de trouver quelques noms. J'ai parlé avec chaque chauffeur pendant plusieurs heures et je les ai suivis dans leurs déplacements. J'ai suivi les itinéraires qu'ils avaient l'habitude d'emprunter, non seulement pendant leur trajet, mais aussi avant et après. Même après les avoir accompagnés, nous parlions encore pendant quelques jours pour détailler les choses que j'avais vues, certaines conversations, leurs relations avec les passagers, avec les habitants... Eux-mêmes se souvenaient alors d'autres histoires à raconter.
Le livre parle d'"eux". Mais aussi d'"eux". Était-il difficile de trouver des femmes qui conduisent des bus ?
Il s'agit d'une profession encore majoritairement masculine. J'ai voulu présenter des portraits de femmes non seulement parce qu'elles exercent également cette profession, mais aussi parce qu'elles sont les personnes les plus à même de décrire l'évolution de cette profession. D'abord pour comprendre ce que signifie être une femme dans une profession dominée par les hommes. Ensuite, pour voir comment la perception des femmes conductrices a changé, tant chez les passagers que chez les collègues. Par exemple, Maria José Cardoso, conductrice chez Carris depuis plus de 25 ans, mentionne qu'elle entend moins de commentaires sur le fait d'être une femme de nos jours, mais qu'elle les entend toujours. Elle raconte que lorsqu'elle a commencé chez Carris, certains passagers, principalement des hommes, avaient des doutes sur le fait de monter dans un bus conduit par une femme. Cette profession est encore loin d'être équilibrée en termes de genre ; les chiffres sont rares, mais j'ai demandé aux principales entreprises de m'indiquer le pourcentage de femmes, et en aucun cas il n'atteint 10%, bien qu'il ait augmenté depuis une vingtaine d'années.
Dans les récits, vous décrivez beaucoup de choses sur la façon dont les gens accèdent à la profession de chauffeur. Les cours de droit qu'ils ont suivis... Le discrédit initial...
En fait, j'étais également très curieux de savoir comment tous ces gens, hommes et femmes, étaient entrés dans la profession. S'agissait-il d'une profession qu'ils souhaitaient exercer depuis leur plus jeune âge, ou d'un hasard de la vie ? Et dans le cas des femmes, c'est curieux parce qu'elles sont venues à la profession parce qu'elles avaient toujours aimé conduire, en particulier des camions. Conduire un bus était donc quelque chose qui leur tenait à cœur et qui leur plaisait. Et dans le cas de Maria José Cardoso comme dans celui d'Helena Nabais, qui est conductrice à Sabugal, il y a un moment où elles doivent faire face à leur entourage, parce que lorsqu'elles disent à leurs amis et à leur famille qu'elles veulent conduire des bus, on leur répond que cela n'a pas de sens et qu'il y a d'autres professions qui sont sans doute plus adaptées. Il y a donc bien un certain courage et une certaine détermination dans leur décision de devenir chauffeur.

Et, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une évolution dans la manière dont les passagers perçoivent la présence d'une femme au volant. Lorsqu'il s'agit de personnes qui les connaissent déjà, la perception de la présence d'un homme ou d'une femme disparaît complètement. Je le vois dans les relations que ces chauffeurs entretiennent avec leurs passagers. Maria José et Helena ont toutes deux des liens très étroits avec les passagers qu'elles transportent et les différences s'estompent.
C'est très drôle et c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé avant de lire ce livre. Ce lien entre les conducteurs et les passagers, même dans une grande ville comme Lisbonne.
Oui, il était très intéressant de découvrir les liens que les conducteurs créent avec leurs passagers. Je pense qu'il y a deux points principaux à retenir. Premièrement, cela dépend beaucoup d'un conducteur à l'autre, cela dépend beaucoup de la personne elle-même. Ce n'est pas nécessairement une caractéristique de la profession. Le travail du conducteur consiste simplement à conduire le bus d'un point A à un point B. La manière dont il le fait, les relations qu'il entretient avec les autres conducteurs, etc. La façon dont il le fait, les relations qu'il établit avec les personnes qu'il transporte, dépendent de la façon dont chacun conçoit cette mission, en quelque sorte. Ensuite, ces liens entre conducteurs et passagers sont liés à la personnalité de chacun : ceux qui sont plus sensibles aux questions sociales, qui aiment discuter et connaître la vie des gens, et ceux qui ne le sont pas. Ce n'est ni positif ni négatif, c'est une question de personnalité.
Pour moi, il est plus surprenant de voir ces liens se créer au milieu d'une ville que dans des endroits où les gens se connaissent et ont souvent des liens familiaux. Dans les petites villes, il est naturel que les conducteurs développent des relations plus étroites avec les passagers. Dans les villes, c'est moins fréquent, mais la mobilité des gens suit des schémas répétitifs ; en d'autres termes, celui qui conduit ce bus tous les jours reconnaîtra, s'il garde les yeux ouverts, les visages et verra les mêmes personnes à maintes reprises. C'est alors une question de temps avant que les gens ne commencent à se saluer ou à faire de petites remarques sur la pluie ou le départ en vacances. Maxime, serre-frein du tram 28, raconte que les relations se nouent presque naturellement avec les gens. Et que les passagers les plus assidus sont heureux d'établir ce lien avec les personnes qui les conduisent. Je pense que c'est ce qui est fascinant dans une ville, qui est généralement un endroit plus anonyme. Dans le chapitre sur Maria José, j'explique comment une ligne de bus peut transformer une ville en village.
Peut-être devrions-nous utiliser ce côté plus interpersonnel dans la communication sur les transports publics par rapport aux transports individuels...
Oui, je le pense. A tel point que si l'on y réfléchit, c'est une autre chose dont je me suis rendu compte en accompagnant ces chauffeurs : beaucoup de gens ne les remarquent même pas. Ils montent et descendent du bus comme s'il n'y avait personne. Et encore une fois, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il y a quelque chose à gagner à se rendre compte que cette personne est là.
Dis-tu bonjour aux chauffeurs quand tu montes dans le bus ?
J'ai toujours eu tendance à dire bonjour...
Et pensez-vous qu'ils aiment être accueillis ?
Je dirais que oui. Je veux dire, ceux à qui j'ai parlé, je suis sûr qu'ils le feraient. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un ne veuille pas être salué, même si ce n'est pas parce que vous vous rendez compte qu'il est là. Un simple "bonjour" ou "bon après-midi" est positif pour les deux parties, en termes de relations humaines. C'est comme aller dans un café et dire bonjour à la personne au comptoir. Maintenant, il y a des services où l'ambiance est plus impersonnelle parce qu'il y a une plus grande rotation ; d'un autre côté, il y a des carrières où l'on va chercher les gens chez eux ou près de chez eux et on les emmène là où ils travaillent, là où ils étudient, là où ils vont chez le médecin... et il y a une ambiance plus familière.
Il est curieux de constater qu'il n'y a pas de photographies dans le livre, alors que les descriptions nous permettent d'imaginer facilement les personnes et les lieux. Cette absence d'éléments visuels était-elle délibérée ?
Oui, c'est un peu mon côté ce que j'aime lire et comment j'aime lire, et comment j'aimerais que ce livre soit lu. J'aime donner à chacun l'espace nécessaire pour dessiner mentalement les histoires, les gens, les lieux... Je pense qu'il aurait pu y avoir des photographies, mais je n'ai pas pensé qu'elles étaient absolument nécessaires pour transmettre l'expérience. Je pense qu'il aurait pu y avoir des photographies, mais je n'ai pas pensé qu'elles étaient absolument nécessaires pour transmettre l'expérience. Si quelqu'un a visité l'Alentejo et connaît l'odeur d'une fin d'après-midi ou le froid d'un matin glacial que je décris, il peut s'y imaginer. Si vous ne connaissez pas ces détails spécifiques de l'Alentejo, vous pouvez les relier à des expériences similaires que vous avez vécues et être capable de vous y retrouver.
En tant que lecteur, j'aime vraiment avoir cet espace, j'aime avoir des descriptions qui me mettent à la bonne place. Ce n'est pas facile, mais ce qu'on m'a appris dans un reportage journalistique, c'est d'essayer de mettre la personne à la place du reportage, d'essayer de décrire avec des mots ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que l'endroit sentait pour moi. Je me suis entraîné à faire cet exercice. Ainsi, lorsque j'écris quelque chose, que ce soit dans le domaine du journalisme ou autre, je me retrouve toujours en train de décrire. Dans le cas présent, j'ai écouté leurs histoires, je les ai beaucoup suivis, je me suis imprégné de la nature de chacun, de la façon dont chacun parlait... et j'ai voulu conserver cela dans le livre, y compris les termes utilisés par les gens. Expressions de l'Alentejo, du Brésil. Des différences dans le langage de chaque personne - par exemple, certains les appellent "moços", d'autres "miúdos", ou "meus meninos"...
Les histoires et les témoignages que vous avez recueillis décrivent les changements sociaux et les différences entre les zones rurales et urbaines, mais aussi l'évolution des conditions de circulation des bus des années 1980 à aujourd'hui...
Oui, du point de vue des conducteurs. Il y a eu une énorme évolution. Tous les conducteurs qui ont déjà conduit au Portugal vous le diront lorsqu'ils se souviendront du froid et de la chaleur qui régnaient dans les bus. De plus, les volants étaient physiquement beaucoup plus grands, il n'y avait pas de direction assistée, les sièges n'étaient pas aussi confortables qu'aujourd'hui, rien n'était ergonomique, et la suspension du siège elle-même n'était même pas conçue en tenant compte du dos du conducteur, comme c'est le cas aujourd'hui, et de la tension qu'implique le fait d'être assis en permanence pendant de nombreuses heures.
En fait, toute la question de la chaleur, du froid, du confort physique de la conduite... a beaucoup changé. En ce sens, il s'agit certainement d'une évolution positive. Je parle ici du point de vue du conducteur, car nous parlons généralement du confort des autobus du point de vue du passager. Je me place du point de vue inverse, car ce sont des gens qui passent des heures à conduire, et ils étaient bien conscients de la douleur dans leur dos, leurs épaules, tout, ainsi que du froid et de la chaleur qu'ils subissaient. Par exemple, une anecdote qui me semble très représentative de cela, c'est celle d'un des chauffeurs qui disait qu'il faisait tellement chaud, tellement chaud, tellement chaud, qu'il avait un jour fait fondre la semelle de ses baskets et que, n'ayant pas de chaussettes, elle était restée collée à ses pieds.

Comment l'écriture de ce livre a-t-elle changé votre point de vue sur la profession de conducteur, que vous avez qualifiée d'invisible ?
C'est une profession que nous connaissons depuis notre enfance, une des professions que nous avons toujours eue à l'esprit. Et réfléchissez, chacun d'entre nous : quel a été votre premier voyage en bus, que ce soit avec vos parents, vos grands-parents, seul, avec des amis, avec l'école ? Il y a ceux qui ont pris le bus pour aller à l'école et qui s'en souviennent. Ceux qui ne l'ont pas pris, mais qui se souviennent des voyages scolaires qu'ils ont faits en bus, des voyages à la plage, etc. Ou plus tard, lorsqu'ils sont allés à l'université ou au travail, ils ont toujours pris le bus. C'est donc dire que je pense que c'est une profession qui existe depuis toujours. Que ce soit parce qu'elle nous est trop familière ou pour une autre raison, nous cessons de la voir.
Après avoir écrit ce livre, ma perception de la profession de conducteur et de son côté souvent invisible a beaucoup changé. Comme je l'ai dit, je ne sais pas s'ils veulent tous que tout le monde leur dise "bonjour" ou "bon après-midi", mais il y a un côté invisible à la profession et je pense que les conducteurs le ressentent. Comme dans d'autres professions, on a tendance à sous-estimer le travail des chauffeurs. Je pense que ce livre nous aide à nous mettre à la place de ces personnes, presque comme si nous étions assis au volant d'un bus, avec les faiblesses que la profession a et que nous avons nous-mêmes. Par exemple, l'une des histoires est celle de José Virgílio Correia, qui a commencé comme chauffeur dans le secteur du tourisme et dont le premier voyage en dehors du Portugal a consisté à emmener des passagers de Londres à Rome. Cette vulnérabilité humaine est l'une des choses que j'ai essayé de montrer ici : nous nous imaginons dans sa position, où le premier jour est consacré à conduire un groupe de touristes à Rome, en parcourant la route pour la première fois.
Cette histoire m'a rappelé celle de Julio, un chauffeur de Carris Metropolitana qui venait d'arriver du Brésil pour conduire des bus dans une région qu'il ne connaissait pas et où, en plus, les passagers étaient exaltés par tous les changements... J'ai vraiment eu de l'empathie pour Julio avec la façon dont vous avez raconté son histoire.
Là, plus précisément, il y avait un système qui entrait en service pour tout le monde - un nouveau système qui était mis en œuvre et qui apportait beaucoup de nouvelles à la fois pour les passagers et pour de nombreux conducteurs. D'une part, les passagers avaient des craintes légitimes concernant d'éventuels manques ou retards de bus, car ils dépendent évidemment de ce transport pour se rendre à leur destination et remplir leurs engagements (il est très difficile d'arriver au travail en retard à cause d'un retard de bus). Mais, une fois de plus, j'ai raconté cette situation du point de vue des conducteurs - et beaucoup d'entre eux partaient de zéro, commençaient même leur vie au Portugal à partir de zéro. Lorsque vous vous mettez à la place des chauffeurs, imaginez que vous montez dans le bus et que vous devez emprunter un nouvel itinéraire, dans un pays différent, à travers des zones que vous ne connaissez pas. Ils vous ont expliqué l'itinéraire, mais ne pas tout mémoriser en détail prend du temps - connaître tous ces petits détails, des endroits les plus étroits aux endroits où les voitures sont habituellement mal garées.